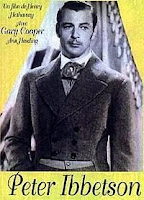De la sciure dans les veines
De retour dans son occupation favorite de dépoussiérage de sa mémoire, Tonton Sylvain, ce brave homme, ne pouvait pas rater l'occasion du passage de ce film de 1952 sur son satellite personnel. Une projection un peu nocturne, certes, mais on n'est pas à ça près quand on est investi d'une mission de cette envergure. D'autant que la chose est signée de Cecil B. DeMille, un monument d'Hollywood, et se présente comme une de ces interminables et spectaculaires sagas dont le Maître était coutumier. De plus, avec un Oscar à la clé, Tonton aurait eu bien mauvaise grâce à manquer l'évènement et l'opportunité de compléter sa collection d'avis autorisés. En avant donc pour l'aventure et pour « Sous le plus grand chapiteau du monde », ou « The greatest show on earth » pour les initiés à la langue de Bernard Shaw.
De retour dans son occupation favorite de dépoussiérage de sa mémoire, Tonton Sylvain, ce brave homme, ne pouvait pas rater l'occasion du passage de ce film de 1952 sur son satellite personnel. Une projection un peu nocturne, certes, mais on n'est pas à ça près quand on est investi d'une mission de cette envergure. D'autant que la chose est signée de Cecil B. DeMille, un monument d'Hollywood, et se présente comme une de ces interminables et spectaculaires sagas dont le Maître était coutumier. De plus, avec un Oscar à la clé, Tonton aurait eu bien mauvaise grâce à manquer l'évènement et l'opportunité de compléter sa collection d'avis autorisés. En avant donc pour l'aventure et pour « Sous le plus grand chapiteau du monde », ou « The greatest show on earth » pour les initiés à la langue de Bernard Shaw.
Affiches USA (movieposterdb.com)
L'histoire est assez simple. Un cirque monumental est sur la sellette au départ de sa tournée annuelle à la limite de ses possibilités financières. Mais le directeur, Brad Braden (Charlton Heston), tient bon face aux financiers et la tournée démarre avec l'argument de l'engagement du Grand Sebastian (Cornel Wilde), une vedette du trapèze volant à la réputation sulfureuse. Comme prévu, les dames de la troupe sont en émoi. Néanmoins s'engage une rivalité entre Sebastian et Holly (Betty Hutton), une consœur accessoirement petite amie de Braden, qui se voit retirer par celui-ci la glorieuse piste centrale pour raisons promotionnelles. La compétition tourne au drame quand Sebastian tombe en pleine représentation en tentant une voltige inédite et en sort handicapé d'un bras. Holly en éprouve une telle culpabilité qu'elle s'écarte de Braden pour se rapprocher de Sebastian qu'elle convainc de rester dans le cirque à un poste d'intendance. Parallèlement, Angel (Gloria Grahame) lui dispute alternativement Braden et Sebastian, suscitant la jalousie de son compagnon Klaus (Lyle Bettger), le dresseur d'éléphants pour qui elle officie. C'est justement cette jalousie qui pousse Klaus à participer au braquage de la caisse du cirque, braquage qui causera un spectaculaire accident de train au cours duquel Braden, grièvement blessé, n'est sauvé que par l'intervention de Sebastian et d'un clown (James Stewart) qui se révèle être un chirurgien en fuite, tandis qu'Holly sauve le cirque lui-même en le relevant de ses ruines.
Affiches Australie (movieposterdb.com)
Autant dire que le scénario tient sur un timbre poste, s'appuyant sur des ressorts d'un classicisme éprouvé : une histoire de couples en recomposition sous l'effet du doute et de la culpabilité ; l'honnêteté et la conviction en sa fonction allant jusqu'au sacrifice de soi-même ; la puissance du dépassement de soi et de l'abnégation face à l'adversité ; un petit brin de jalousie et ses conséquences néfastes ; la force des valeurs et des bons sentiments. Pour le piment, on ajoute bien une petite touche d'appât du gain et de mauvais garçons, mais on sent bien que le cœur n'y est pas, qu'il s'agit d'un piment très doux, et que l'essentiel est ailleurs.
Affiches Allemagne (movieposterdb.com)
Même la scène de la catastrophe ferroviaire, toute spectaculaire qu'elle soit, ne parvient pas à dépasser le statut d'intermède autant dramatique que ludique dans une trame d'une autre dimension.
Affiche Belgique (movieposterdb.com)
Il suffit d'ailleurs d'écouter la voix de Cecil B. DeMille en narrateur introduisant la première minute du film pour réaliser où se situe le centre du sujet. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, d'observer le casting peuplé d'une myriade d'artistes de cirque dans leurs propres rôles. Tourné sans « les locaux » d'un vrai géant du cirque américain, Ringling Brothers, Barnum and Bailey, et ne manquant jamais de faire apparaître la référence à son identité, alimenté par toute une série d'anecdotes saisies par le réalisateur dont on dit qu'il a préparé son tournage en suivant deux mois de la tournée du vrai Barnum, le film est avant tout une présentation de la magie et du spectacle du cirque. L'histoire n'est qu'un fil conducteur entre des numéros reproduits par leurs auteurs réels. Contrastant avec la réalité de la piste à laquelle se mêlent les comédiens, les vues du public sur les gradins ont quelque chose de figé, l'occasion de fixer quelques attitudes éphémères. On y croise d'ailleurs quelques visages connus qui n'ont d'autre fonction que celle de faire valoir par une apparition de quelques secondes au milieu d'une foule : Bing Crosby, William Boyd, Bob Hope, Diana Lynn, ...
Affiche France (moviepsterdb.com)
Une fois posée cette trame, il ne reste plus dès lors qu'à se laisser emporter ou non par le charme de la présentation, selon sa sensibilité, un œil sur toute une série de performances, un autre sur les coulisses, en suivant distraitement l'histoire qui sert de toile de fond. La qualité des acteurs n'a ainsi finalement que peu d'importance, même si Charlton Heston, dont il s'agit ici du premier rôle principal, et James Stewart, qu'on reconnaît à peine sous son maquillage permanent, sortent du lot. Et il faut bien avouer une certaine dextérité du réalisateur à mêler son histoire conductrice aux numéros de piste. Même si l'histoire est relativement basique, on finit facilement par se prendre au jeu sans réelle frustration ni sentiment de décalage.
Affiches Espagne (movieposterdb.com)
On dira ce qu'on voudra, mais le Hollywood de ces années là, savait prendre un sujet et en faire un spectacle intéressant même à partir d'un support aussi sommaire. Pas de quoi porter au firmament une étoile incandescente à chaque fois, mais de quoi sortir Tonton Sylvain de son lit pour aller rêvasser avec plaisir devant un écran nocturne en tout cas. On peut demander davantage au cinéma, certes, mais on peut tout autant se satisfaire de cette récréation avant de replonger, le coeur apaisé dans des oeuvres plus austères. Et ça, ça ne manque pas ; mais c'est une autre histoire.
Affiche Grande Bretagne (movieposterdb.com)