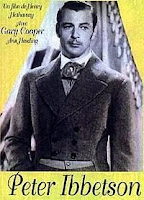Espérons encore dans le Beaujolais
James Bond est de retour. C’est l’automne et revient le temps des feuilles mortes, des marrons chauds, des cache-nez, des bottines en cuir, du cassoulet, des prix littéraires, et du nouveau James Bond. Crise financière ou pas, le monde ne s’arrêtera pas de tourner. D’autant qu’il ne sait rien faire d’autre, le monde, que de tourner. Et James Bond n’arrêtera pas de faire exploser les méchants. D’autant qu’il ne sait rien faire d’autre, James Bond, que de faire exploser les méchants. Autrefois les méchants s’appelaient Curt Jurgens, Christopher Walken, Yaphet Kotto, Michael Lonsdale, Christopher Lee, Max Von Sydow … Maintenant ils s’appellent Mathieu Amalric, mais ça ne change rien. Autrefois ils oeuvraient à la tête d’une organisation du nom de Spectre. Maintenant ils dirigent une organisation du nom de Quantum, mais ça ne change rien. Ils étaient là pour se faire exploser par James Bond. Maintenant ils sont là pour se faire exploser par James Bond. Rien de nouveau sous le soleil, ni sous le vent d’automne.
 Affiche France (cinemovies.fr)
Affiche France (cinemovies.fr)
Une petite nouveauté avait bien tenté une tête avec l’arrivée du premier James Bond à l’allure d’agent russe, plus slave que nature, sous la couverture d’un dénommé Daniel Craig. Mais bon, la surprise est passée, si ce n’est l’aura animale de l’individu qui n’en manque certes pas aux dires de mes voisines ahanantes d’exaltation. Un an après « Casino Royale » qui avait vu le petit nouveau se faire occire la fiancée, le MI6 se retrouve à devoir maîtriser les appétit vengeurs du Commandeur, pour une suite annoncée comme prenant immédiatement le relais de l’épisode précédent. Ce dernier étant revenu sur la première des aventures du mythique espion, c’est donc pour la suite du début que l’automne de cette année bat le rappel des spectateurs avides d’habitude et de respect de la tradition.
 Affiche Russie (cinemovies.fr)
Affiche Russie (cinemovies.fr)
Tout commence par une poursuite en voiture dans un tunnel routier, sur la corniche italienne. Aston Martin contre Alfa Romeo. On ne pouvait plus clair ! Les plans se succèdent à un rythme épileptique jusqu’à, naturellement, ce que le beau Bond (Daniel Craig) se débarrasse de ses poursuivants et atteigne la vieille ville de Sienne où il engouffre son auto délabrée par une porte cochère anonyme et automatique dans un souterrain inattendu au bout duquel il peut livrer le colis qu’il a dans le coffre à quelques coéquipiers menés par l’illustre M (Judi Dench), la cheftaine en chef des baroudeurs de Sa Très Gracieuse. Le colis est sommairement réanimé, ligoté sur quelque tabouret, puis interrogé de dos par M et Bond.


Affiches USA (movieposterdb.com)
On a d’ailleurs droit à l’occasion à la seconde surprise de l’épisode. Il était ainsi de tradition que la scène cascadeuse introductive n’ait que peu de rapport avec le reste de l’action. Foin de tradition ici, et tant pis pour les nostalgiques : il y aura un rapport, et puis c’est tout. C’est le début de l’histoire, qu’on le veuille ou pas. C’est comme ça. Et puisqu’on y est, on réalise à ce propos qu’on avait à peine remarqué la première surprise qu’avait été le générique, toujours aussi psychédéliquement 70 qu’à l’accoutumée, mais sans plus de référence à la grande tradition des génériques de James Bond que la fugace apparition d’un discret disque blanc modèle réduit qui traverse une partie de l’écran. Pour une version plus classique de la chose, il faudra attendre le début du générique de fin, qui retrouvera tous les codes usuels du générique de début du James Bond classique avant de s’effacer sur l’ordinaire litanie des participants à la fabrication du film. Renversant bouleversement que de retrouver le début à la fin ! Y aurait-il un message là dessous ?

Affiche Arménie (movieposterdb.com)Quoi qu’il en soit, l’interrogatoire de Mr White (Jesper Christensen), puisque c’était lui qui occupait le coffre de l’Aston Martin, tourne à la confusion avec la révélation de l’existence d’un traitre au sein du MI6, vite occis par le beau James après une nouvelle série de cascades poursuiteuses dans le vieux Sienne. A la suite de quoi, M, toute marie de l’attentat auquel elle a échappé de justesse, envoie Bond sur la seule piste que ses services lui indiquent, quelque part en Haïti.
Affiche Chine (movieposterdb.com)


Affiche Honk Kong _________Affiche Taïwan(movieposterdb.com)
Ci-tôt dit, ci-tôt fait, Bond est sur place, débusque la cible, Mr Slate (Neil Jackson), l’occit dans un excès de précipitation avant de tomber sur la cible que la cible devait elle-même occire, Camille (Olga Kurylenko), une belle brune à la carrière de James Bond Girl toute tracée. M, qui suit les aventures de son poulain depuis les brumes londoniennes, commence un peu à en avoir ras le casque de voir Bond refroidir les pistes à mesure qu’il les approche, et elle commence à le faire savoir. Mais James s’en fiche. C’est lui le héros après tout. Et puis si son attitude lui est reprochée, elle lui est en même temps pardonnée du fait de la colère qui l’habite depuis que Vesper, sa Dulcinée de « Casino Royale », avait été trucidée et qu’il en est resté d’une infinie tristesse bondienne, autant dire dans une froide recherche de vengeance.

Affiche Corée (movieposterdb.com)
Mais revenons en Haïti. Quelques cascades plus tard, juste histoire de ne pas perdre la main, James espionne Camille, qui lui a échappé, alors qu’elle rencontre sur les docks Monsieur Greene (Mathieu Amalric), son amant qui avait décidé de la faire occire par la cible occise par Bond, et alors qu’il la livre à un odieux putschiste bolivien, le Général Medrano (Joaquin Cosio), avec qui il est en affaire. L’odieux avait déjà quelques années plus tôt occis toute la famille de la belle qui rêve manifestement de se venger. Se méprenant et croyant la belle en danger, James se lance dans une série de cascades poursuiteuses nautiques et libère Camille très pas contente qu’il lui ait fait rater son approche de sa cible à elle. Greene en profite pour prendre un avion privé en compagnie de deux agents de la CIA, Felix Leiter (Jeffrey Wright) et son chef, Gregg Beam (David Harbour) qui roule pour lui-même, en direction de l’Autriche. James les suit dans un autre avion et tout le monde se retrouve à une représentation de La Tosca où Greene anime une réunion secrète de Quantum, les participants, oreillette à l’oreille, murmurant leur débat dispersés au milieu de la foule des spectateurs. James met son grain de sel, repère quelques participants, et se lance dans quelques acrobaties. Il laisse sur le carreau un agent des services spéciaux infiltré, ce qui fâche M tout rouge, au point de lui faire couper les vivres à Bond.

Affiche Japon (movieposterdb.com)
James se rabat sur un petit voyage en Italie pour recruter l’aide de Mathis (Giancarlo Giannini) qui le suit alors en Bolivie où il ne tarde pas lui-même à se faire trucider, de même que Mademoiselle Fields (Strawberry Fields d’après le générique de fin) (Gemma Arterton), la représentante de l’ambassade britannique venue à l’aéroport sommer Bond de rentrer au bercail avant de succomber à son charme. Quoi qu’il en soit, nouvelle rencontre de Bond et de Greene, et retrouvailles avec Camille déjà sur place qu’il sauve une nouvelle fois des griffes du chef de Quantum.
 Affiche Vietnam (movieposterdb.com)
Affiche Vietnam (movieposterdb.com)Quelques cascades aéroportées plus loin, et on comprend enfin au passage le but de Quantum de s’approprier les ressources en eau pour assoiffer les populations et en tirer profit, tout le monde se retrouve au milieu du désert pour la signature de l’accord définitif entre l’odieux général Medrano et Greene, avec grain de sable importé par Bond et Camille, bagarre générale, et explosions à tous les étages.
 Affiche Israël (movieposterdb.com)
Affiche Israël (movieposterdb.com)Une petite scène finale pour raccrocher les wagons avec l’histoire du deuil de Vesper qu’il faut bien clore par une vengeance en bonne et due forme pour qu’on arrive enfin à la fin de ce début de l’épopée du beau Bond, qu’on avait d’ailleurs rarement vu autant couvert d’ecchymoses et de cicatrices dans ses aventures ultérieures antérieurement mises à l’écran (… Ca va ? Ca suit, dans le fond ?), et voilà l’travail !
 Affiche Allemagne (movieposterdb.com)
Affiche Allemagne (movieposterdb.com)Si l'on en croit le dossier de presse, et Vox Populi, les scènes d'action ont pris une telle place dans cette nouvelle mouture de James Bond que cela tournerait à l'exercice d'école. Autant dire que l'histoire aurait peu d'importance et se limiterait à l'argument d'un lien entre les cascades. Un peu comme la télévision avait pu être décrite il y a quelques années par Patrice Lelay, ex-PDG de Béton TV, comme un moyen de maintenir le téléspectateur captif d'une page de publicité à la suivante. Ce serait néanmoins ne pas faire honneur à la qualité du scénario concocté par Paul Haggis, Robert Wade, et Neal Purvis pour le compte du réalisateur Mark Foster, épaulé du réalisateur en second, Dan Bradley.
Si Mark Foster n'avait jamais tourné une scène d'action plus échevelée que dans « Les cerf-volants de Kaboul », Dan Bradley est un spécialiste du genre, avec une longue carrière de cascadeur et de réalisateur en second sur des productions du genre de la série de Jason Bourne. Drôle d'association, sauf si on se dit que Haggis, compromis dans la réalisation de « Dans la vallée d'Elah », n'est pas Lelay, et qu'il semblait bien y avoir déjà, dès le choix de l'équipe, une volonté de faire de ce Bond là une mixture jouant sur tous les tableaux.
De fait, et comme l'annonçait immédiatement le générique, on se lance ici dans une casse en règle des codes du James Bond, et ce dans la droite ligne de ce qu'avait entamé « Casino Royale ». James Bond était un aristocrate de l'espionnage, pas avare de ses poings, mais jamais décoiffé et toujours tiré à quatre épingles. Un genre de version originale de l'OSS 117 de Jean Dujardin. Il devient ici un bagarreur émérite qui encaisse les coups même s'il finit par l'emporter avec son lot de balafres. Il était macho et collectionneur sans état d'âme. Il devient mû par la passion du deuil et par la vengeance. Il était cynique, drôle, pince sans rire et flegmatique. Il devient touchant, touché, à l'humour rare, impliqué, parfois emporté. Il était dévoué au service de Sa Très Gracieuse, rappliquant au moindre appel de M et dragueur de Moneypenny devant l'Eternel. Il devient franc-tireur, rebelle, sans la moindre idée de qui peut bien être Moneypenny au point qu'elle ne figure même plus au scénario. Il était bardé de gadgets et de technologie loufoque. Il n'a plus d'outil plus sophistiqué qu'un téléphone portable dernier cri. Il affrontait des fous géniaux qui n'avait comme plus simple motivation que le désir d'être Maître du Monde. Il se collète maintenant avec des affairistes retors et sans scrupules. Bref, il était une caricature de bande dessinée, il devient un héros de polar humain évoluant dans un monde complexe, à la recherche, plus que de vengeance, d'un minimum de consolation, littéralement d'un « Quantum of solace ». Les plus taquins ont pu dire d'un « lot de consolation, » mais l'ironie était facile !
C'est-y pas un projet ambitieux, ça, de tirer James de la bande dessinée pour le tirer vers le monde des humains ? On peut se demander si ça valait le coup, si ce n'était justement pas une bonne chose d'avoir conservé un personnage aussi bien formaté depuis tant d'années, si ce n'était justement pas le lot de consolation du spectateur après s'être avalé toute une année de productions bourniennes de pouvoir respirer avec ce gugusse du MI6, son cheptel de potiches miss-monde-like et sa panoplie d'Inspecteur Gadget. Mais après tout, si on accepte l'objectif, on peut reconnaître la difficulté de la tâche, et pourquoi pas la maîtrise de l'ouvrage. Un peu comme on pouvait remarquer la hauteur du défi d'intégrer des scènes porno réelles dans un film classique au motif que cela fait autant partie de la vie que les états d'âme les plus nobles. Le tout était de s'y prendre correctement. Que cela soit une réussite ou pas est un autre débat. Et rien ne dit que toute tentative doive être toujours couronnée de succès. Bref, reconnaissons la tentative, ajoutons qu'on n'y voit pas d'intérêt, et on aura dit l'essentiel sans qu'il soit davantage utile de commenter la réalisation totalement au service de l'objectif.
Au service de cet objectif également, Mathieu Amalric fait de son mieux en méchant d'occasion. Il a le regard torve et la morgue vindicative. Peut-être un peu trop, du reste, pour être parfaitement cohérent avec le peu qui reste du James Bond de pacotilles et de paillettes. Olga Kurylenko est pour l'essentiel assez convaincante si ce n'est quelques regards qui dépassent un peu le crédible (l'expression de surprise impatiente et soulagée à l'approche de Medrano est un grand moment involontaire de rigolade). Daniel Craig et Judi Dench assurent leurs jobs en bons pros qui savent suivre un cahier des charges. Joaquin Cosio fait un Général Medrano sans ambigüité sur ses mauvaises intentions, et complètement inconscient de ce que le nom de son personnage peut évoquer de théâtral pour le public français. Comment le saurait-il, d'ailleurs ? Peut-être seul Amalric était-il conscient de la chose et on peut admirer sa performance de n'avoir pas éclaté de rire à chaque prise, d'autant qu'il devait avoir été mis d'humeur potache par le nom de son personnage à lui, Dominic Greene, un des premiers terroristes Vert (green en grand-breton) du grand écran.
Juste pour le fun, signalons la participation de Oona Chaplin, petite fille de Charlie et homonyme de l'épouse du grand homme, en serveuse d'hôtel malmenée par Medrano, et celle de Guillermo del Toro pour une voix additionnelle qu'on peut s'amuser à découvrir.
Et si en sortant de la projection, on se retrouve vite plongé dans un vent automnal qui pousse irrémédiablement vers une platée de cassoulet, on y va en se disant que le James Bond de cette année est d'une bien curieuse cuvée. Pourvu que le Beaujolais ne se mette pas à avoir un goût de Chardonay, qu'il nous reste au moins ce dernier carré de tradition !
Lire la suite...